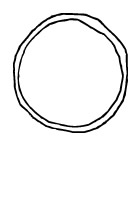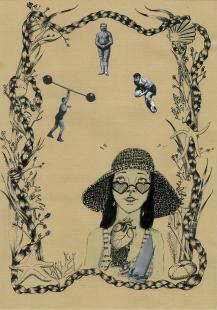« C’est génial, tu vas au Japon et un Japonais est venu à ton anniversaire ». Cette blague un peu bête a été glissée à un ami qui fête ses 30 ans et a reçu un beau voyage en cadeau. Mon mec vient de pousser la porte de ce bar à vin du XVIIIe arrondissement de Paris où nous passons la soirée. Ces parents sont des Chinois nés au Laos qui ont émigré en France une dizaine d’années avant sa naissance. Les invités eux, des journalistes, des gens qui bossent dans la communication, le commerce ou la politique, tous à bac + 5 minimum. Et la boutade souligne qu’il y a un « jaune » dans cette soirée de « blancs ». Cette plaisanterie au goût amer venait couronner le sentiment diffus que même si mon entourage est plutôt bienveillant et ouvert, il n’est pas exempt de préjugés, bien au contraire.
Combien de fois m’a t-on demandé : « Il vient d’où ton mec ? ». L’occasion de donner en souriant cette réponse apparemment décevante : « Saint-Denis, dans le 93 ». Là où il est né, là où il a grandi. Certains se contentent de cette réponse, semblant attendre un complément d’information qui ne vient pas, d’autres ne doutent de rien et enchaînent sur un « nan mais je veux dire ses origines ? ». Est-ce si important ? Quel genre de doute a besoin d’être levé à propos de quelqu’un qui parle un français parfait, évidemment sans aucun accent? D’un coup, on se permet de questionner l’arbre généalogique d’une personne que l’on vient de rencontrer. Ses yeux sont bridés, ses cheveux noirs de jais, les infos sont là. Sans le vouloir, ces questions à répétition stigmatisent car elles insinuent que même né et élevé en France, il resterait différent et la question mériterait donc d’être posée. Or il n’a pas moins de mérite d’avoir des parents nés ailleurs, comme d’autres n’en ont aucun d’avoir plusieurs générations d’ascendants nés en France. Qu’ont-ils fait de plus pour ne pas avoir à répondre à ces interrogatoires ?
Sans mauvaise intention, des personnes qu’il connait à peine me demandent : « et quand est ce qu’il nous fait à manger ? ». J’ai envie de leur répondre que tous les Asiatiques ne sont pas là pour leur servir du phô, des raviolis, ou du riz cantonais ; il n’a pas à faire cet effort hormis pour ses proches, car il n’a pas de faveur à rendre. Il n’est pas en train de chercher à s’intégrer, en invitant des gens à dîner comme si nous vivions dans un pays étranger. Personne ne demande à un blanc qu’il vient de rencontrer de lui faire à manger. A nouveau, ces phrases instillent l’idée qu’il y a différentes catégories de citoyens, ceux qu’on questionne, à qui on demande d’en faire plus, et les autres.
Lui accepte complètement ces questions, il les accueille toujours avec le sourire. Notamment parce qu’on lui a appris, ses parents en premier lieu, à ne pas « faire de vagues ». Son éducation lui intime de rester gentil, calme, et d’encaisser les petites phrases qui mises bout-à-bout questionnent finalement sa présence sur le territoire. Il sourit aussi parce que là où il a grandi, à Saint-Denis, tout le monde est enfant d’immigré et tout le monde vanne les origines des uns et des autres. Mais intra-muros, après avoir fait des études et finir par naviguer dans un monde de communicants, de graphistes ou de réalisateurs, la dynamique change, la diversité disparaît, les vannes sur les origines ne vont plus que dans un sens.
Nous avons aussi vécu plus de deux ans ensemble au Canada, dans des milieux francophones. Un pays où il y a beaucoup d’asiatiques mais surtout à Toronto et Vancouver. En arrivant au sein d’une rédaction dans laquelle j’ai travaillé, je parle naturellement de mon copain à quelques collègues, montre des photos. Quelques jours après, une collègue vient à mon bureau : « Il paraît que ton copain est asiatique ? » Serait-elle venue me voir si mon copain était blond ? Ou pour être un peu plus original, disons, roux ? Que mon amoureux soit asiatique semblait être une drôle de particularité, qui valait le déplacement dans l’open space. J’avais apparement fait un choix étonnant de compagnon.
Quand je l’ai rencontré, j’ai bêtement cru qu’il était métisse. Il est grand, a de larges épaules, une voix bien grave et assurée. Il n’est ni introverti, ni discret, ni timide ou effacé. J’avais donc moi aussi ma dose de préjugés. Je me suis laissée être corrigée par cette rencontre sans poser de questions. Le pourquoi du comment de ses paupières sans pli ne m’intéressait pas. Je n’avais pas besoin de comprendre d’où cela venait, puisque notre coup de cœur l’un pour l’autre me donnait surtout envie de découvrir sa personnalité. C’est au fur et à mesure que j’en ai appris plus sur ses parents. J’ai découvert l’existence de la ville de Vientiane, la capitale laotienne, là où ils sont nés. Ce n’est que des semaines après notre rencontre que j’ai appris qu’il parlait chinois, lorsqu’il leur a répondu au téléphone. Et puis un jour, il m’a fait à manger.
J’ai bon espoir que ces remarques finissent par disparaitre car dans les familles, un couple mixte ouvre une porte qu’on ne pensait pas avoir besoin de pousser, celle qui fait entrer chez soi quelqu’un qui ne nous ressemble pas. Sans qu’ils l’aient cherché, les parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, en apprennent davantage sur une autre culture et comme moi balayent gentiment les préjugés qui leur restaient. Ca vaut aussi pour les amis proches qui, quelque soit leur propre origine, font parfois entrer dans leur cercle pour la première fois un asiat, un noir, un arabe, un blanc, etc.
J’ai bon espoir car ma grand-mère, 90 ans, atteinte d’Alzheimer et qui vit depuis plus de 30 ans dans un coin très isolé en Bourgogne n’a fait absolument aucune remarque sur l’apparence de mon amoureux lorsqu’elle l’a rencontré. Enfin si mais pour dire qu’il était très beau.