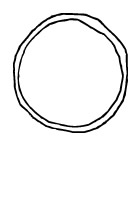Faire ne pas faire faire ne pas faire faire ne pas faire. Tous les jours, je m’assois, j’essaie d’être productive et c’est le blocage. Quelle discipline, quel secret, quelle méthode appliquer ?
Un jour pourtant je me suis levée et j’ai passé les grilles. Voilà mon expérience de formation, le retour à l’École qui m’a désengourdie.
Six ans après mon laborieux dernier contact avec les études supérieures, je me suis retrouvée sur le perron de cette école supérieure “des arts et industries graphiques”, avec, dans un sac à l’épaule une pochette (vide), un cahier (vierge) et quelques crayons. Panoplie étudiée de néo-étudiante, volontaire, fraîche mais mature. Je me souviens que j’avais gardé mes lunettes, qui ne me servent qu’à survivre en milieu hostile, pour me donner de la contenance et l' »air intelligent« . Tout dans la posture. Je n’imaginais pas grand-chose de ce qui m’attendait, le tote-bag rapidement transformé en sac à dos sur ordre de l’ostéo, cette vie en microcosme fermé - 10 personnes côtoyées 8h30 par jour, 6 jours sur 7-, la vie sociale en sourdine.
Un apprentissage relationnel accéléré. Les appréhensions du premier jour, régressives et enfantines, tous ces visages dans la pièce tellement hors de ma zone de confort, ne se conformant en rien à l’image abstraite que j’avais de ma promo 2016. Que des filles, toutes ces filles pour un seul garçon. Les alarmes s’affolent, sacré potentiel d’ambiance malveillante, de jugements mesquins. L’avenir me donnera tort, dans cet ensemble bigarré seul le garçon aura des crises de princesse reloue, les autres se révéleront être d’une gentillesse sans égal. Celle qui qui a passé 20 ans dans la pub, MILF attachante à la voix d’Amanda Lear. Une autre qui ne sait pas trop la fermer, qui saoule les intervenants, imaginée l’été avec un pull sur les épaules et un labrador à l’île d’Yeu. Celle qui se surpasse en gâteaux. Ou la fille enceinte jusqu’aux yeux, belle à tomber par terre, caractère vénère bouillonnant, qui a du faire pleurer des profs au lycée. Ou encore la plus jeune, pleine de fulgurances, le rouge qui enflamme vite ses joues.
Tous ces gens qui n’étaient tellement pas moi, au contact électrique.
Avant ça, il y avait eu trois ans en état de mort cérébrale, dans un bureau. Il aura fallu des mois d’ennui et de désarroi avant d’avoir le courage de m’en défaire, de dire “Salut les gars, finalement je préfère la précarité à cette nullité ambiante“.
Pour la première fois, j’étais contente de me lever le matin, même le samedi, parfois surtout le samedi. Le samedi, il n’y avait personne dans les murs à part nous onze, l’intervenant, les gâteaux et le gardien du week-end en pyjama. La première fois que j’ai dévalé les escaliers un samedi matin, j’ai dit à qui était là « j’ai l’impression d’être dans le Breakfast Club ! » Je l’ai redit une fois arrivée en classe, toujours personne pour saisir la référence. Personne n’avait entendu parler du Breakfast Club. J’ai eu envie de partir, je ne suis pas partie et j’ai bien fait.
Quel étrange environnement scolaire, où tout le monde jouait le jeu. J’étais restée sur un tel sentiment d’échec vis à vis de l’enseignement supérieur. Entre la conviction que ce ne n’était pas pour moi, que ma licence avait été vraiment décrochée en magouillant, et le regret d’avoir plus ou moins saboté non pas deux, mais trois années de maitrise. L’impression de la découverte la forme d’apprentissage idéale, le petit effectif, le traitement d’égal à égal, l’exigence, l’absence de paramètres disciplinaires… et surtout mon envie de bien faire et mon application, pas l’once d’un élan de procrastination. Une révélation.
A froid je relativise un peu, mais j’ai été envahie d’idées révolutionnaires, scandalisée, sans comprendre pourquoi les « parenthèses utiles » si répandues au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves n’étaient pas encouragées en France. A rentrer après le bac un temps dans la vie active avant d’entamer des études, mon parcours aurait été, pensai-je avec véhémence, plus glorieux, moins hasardeux, plus affiné. Qui sait. Je me suis en tout cas découverte infiniment plus réceptive à l’intégration d’un savoir que je ne pensais pouvoir encore l’être.
Les formation professionnelles, sur le papier, c’était surtout avoir le choix entre tourneur-fraiseur et community manager. Il a fallu faire de la spéléo au fin fond d’internet pour trouver une formation un peu « intellectualisante« . Qui à ma grande surprise m’a été financée. Via laquelle je me suis retrouvée, à chaque pause, mélangée à la faune originelle de l’établissement, entourée de grands bébés post-bac, en bleu de travail ou cartons à dessins sous le bras, des minettes de 20 ans gaulées comme la mort ou le visage encore ravagé de boutons, des prom queens et des petit mecs à la mèche emo que j’avais envie de prendre par les épaules et de rassurer - faut me croire, la vingtaine c’est VRAIMENT mieux que le lycée, tout arrive, tu es sauvé.
L’impression du meilleur des mondes. Sage des claques prises ces dernières années, apte à tenir une conversation sur un peu tout, et encore assez fraîche pour me fondre dans la masse des étudiants.
Et puis un jour le vigile du supermarché avoisinant, à qui j’expliquais que mon sac à dos n’était pas une menace, qu’il ne contenait que des cahiers, me répond sans une fraction de seconde d’hésitation : « Ah, vous êtes professeur ? » L’uppercut. Une robe trop courte, des baskets trouées, une peau à problèmes, et pourtant son cerveau n’a pas un instant tenté de me classifier au coté des élèves qui grouillent dans le quartier. J’ai eu l’impression d’être décalée, déphasée, démasquée, moi la veille personne à acné.
Et pourtant hormis ce vilain shot de réalité, il me semble que cette formation, ces mois de sursis ont changé ma vie, entrouvert une fenêtre. Un sentiment d’urgence aussi, tout ce temps à rattraper, ces journées interminables où mes neurones se suicidaient par paquets de 10 000.
Alors qu’à l’école même les intervenants les plus faiblards distillaient çà et là des choses enrichissantes. Et dans les moments fructueux, un petit miracle, la porosité aux connaissances auxquelles on m’exposait, se sentir challengée par les exercices, parfois en freinant dans quatre fers, en serrant les dents, pour un résultat toujours gratifiant. La satisfaction de débloquer des issues, écrou par écrou, de me décoincer. Résoudre des équations mentales qui faisaient soudainement plein jour sur des parties inexplorées de mon cerveau. Je finissais chaque journée un peu abasourdie, un peu k.o., rincée, vidée, incapable d’ouvrir un livre, mais vraiment très heureuse.
Après l’examen final, la soutenance, l’apéro et la gueule de bois géante, il y a ce grand vide, un peu terrifiant. Les autres se tapaient dans le dos, larmes de joie aux yeux à l’idée des Vacances Bien Méritées. Moi je la ramenais pas trop, j’avais l’impression d’être en bout de plongeoir au dessus d’une piscine vide. Finies les journées sur des rails, les encouragements quotidiens. Il va falloir tirer profit de tout ça, se prendre par la main, ne pas laisser s’essouffler cette dynamique. Assommer le Monstre du Doute (cet économiseur d’écran du cerveau, qui profite de chaque moment de relâche pour persifler « AH QUOI BON”) et utiliser les outils accumulés pour construire quelque chose dont je serais enfin un peu fière.
C’est la fin de mon plaidoyer pour l’école dans ses formes les plus iconoclastes, pour les énièmes chances, pour la formation continue. Il faut chercher et s’acharner pour les débusquer, mais il en existe dans tous les domaines d’application imaginables. Si moi, qui me noie dans tous les verres d’eau, j’ai réussi à faire ce mini pas de géant, je crois en vous, foule planquée de late-bloomers frustrés.